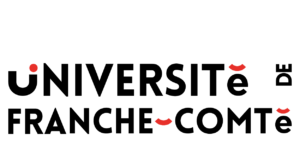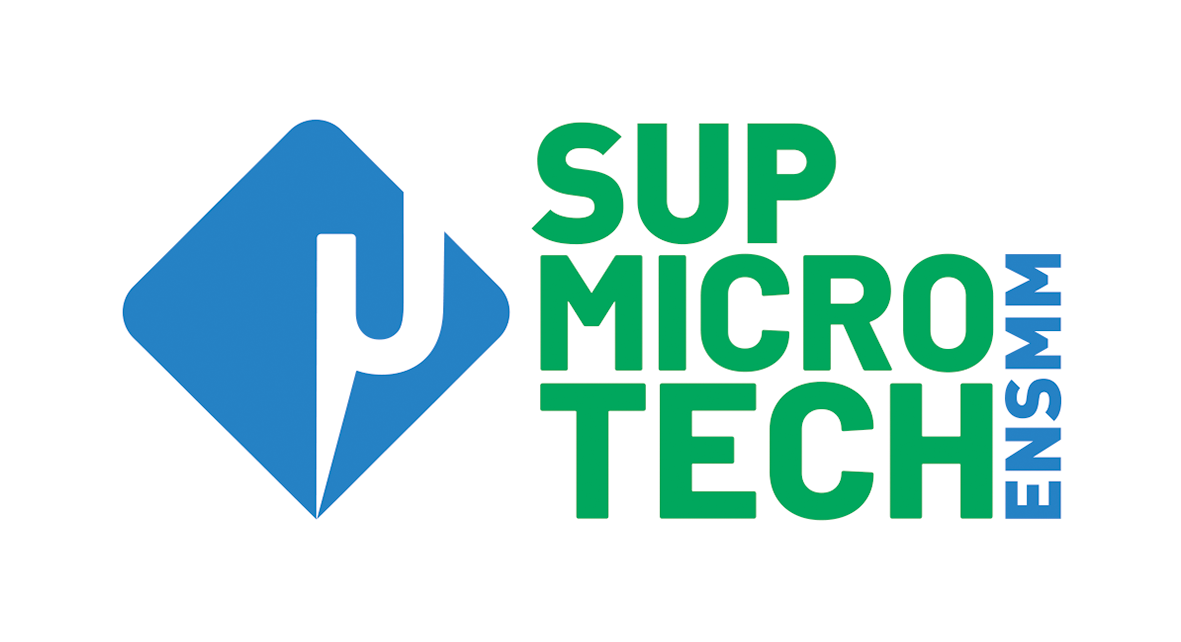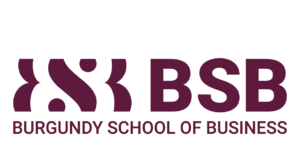Moins de gel sur le Mont-Blanc avec le réchauffement climatique

Les conséquences du changement climatique sont déjà bien visibles dans les Alpes, mais qu’en sera-t-il à la fin du siècle ? Une équipe de chercheurs des universités de Bourgogne et de Franche Comté a mené une étude sur le massif du Mont Blanc pour prévoir l’évolution des températures jusqu’en 2100 : une baisse drastique du nombre de jours de gel est à prévoir.
Dans les Alpes, le réchauffement climatique pourrait entraîner, à la fin du XXIème siècle, une réduction du volume des glaciers, une diminution de l’enneigement, voire même un déficit en eau. Au final, les milieux de haute montagne pourraient se voir transformés de manière spectaculaire.
Cependant, les modélisations à l’échelle globale qui ont permis de faire ces pronostics restent peu précises. C’est pourquoi des chercheurs du laboratoire Biogésciences (UMR 6282 CNRS-uB) et du laboratoire ThéMA (UMR 6049 CNRS – Université de Franche-Comté) ont décidé de travailler ensemble pour affiner les modèles climatiques sur une zone particulière : le massif du Mont Blanc. Ce programme de recherche, baptisé VIP-Mont-Blanc, est financé par l’ANR1.
Pour déterminer l’évolution des températures à l’échelle d’une région et sur des reliefs de montagne, ils ont utilisé un algorithme inédit, construit à partir des simulations de 13 modèles climatiques globaux ayant modélisé le climat de 1950 jusqu’en 2100. Ainsi, au lieu de la résolution de l’ordre de 100 à 200 kilomètres fournie par les modèles les plus récents, ce nouvel algorithme leur offre une précision de l’ordre de 200 mètres et, par conséquent, des estimations de température beaucoup plus fines.
Différents scénarios
Les chercheurs ont envisagé deux scénarios : l’un, optimiste, qui maintient le réchauffement global en dessous des 2°C conformément aux termes de l’accord de Paris, et l’autre, plus pessimiste, avec une augmentation des températures de l’ordre de 5 à 6°C par rapport à l’ère pré-industrielle. « Actuellement, le premier objectif semble difficile à atteindre et il semble qu’on se dirige actuellement vers la deuxième option », remarque Benjamin Pohl, l’un des auteurs de cette étude.
Avec l’option la plus optimiste, les résultats montrent clairement une diminution du nombre de jours de gel, mais celle-ci resterait relativement faible par rapport à aujourd’hui et le climat se stabiliserait durant la seconde moitié du siècle. En revanche, dans le scénario pessimiste, les résultats prévoient pour la fin du XXIème siècle des diminutions très importantes et toujours croissantes du nombre de jours de gel. En hiver, l’impact serait le plus important dans les vallées avec une diminution de 30% des jours de gel et resterait très prononcé jusqu’à 3000 mètres d’altitude, où la fréquence de dégel pourrait croître de 30%. Les précipitations pluvieuses pourraient en partie remplacer les chutes de neige, rendant plus incertaine la pratique des sports d’hiver.
En été, c’est la haute montagne qui serait la plus touchée : à des altitudes comprises entre 3500 et 4000 m, les jours de gels pourraient diminuer de 45 à 50% par rapport à aujourd’hui. Des évolutions similaires seraient enregistrées jusqu’au sommet, alors que ce type d’événement reste rarissime à l’heure actuelle. « Ce qui est actuellement une exception pourrait donc se répéter environ un jour sur trois en fin de siècle », explique Benjamin Pohl.
Cette augmentation de la température pourrait donc induire des bouleversements environnementaux importants, jusqu’alors jamais observés, qui modifieraient en profondeur le fonctionnement des écosystèmes et obligeraient l’homme à s’adapter.
- Agence nationale pour la recherche
Référence :
Benjamin Pohl, Daniel Joly, Julien Pergaud, Jean-François Buoncristiani, Paul Soare et Alexandre Berger 2019. Huge decrease of frost frequency in the Mont-Blanc Massif under climate change. Nature Scientific Report 9, 4919. doi: 10.1038/s41598-019-41398-5.
www.nature.com/articles/s41598-019-41398-5
Contacts :
Jean François Buoncristiani
Laboratoire Biogéosciences
Université de Bourgogne
jfbuon@u-bourgogne.fr
Benjamin Pohl
Laboratoire Biogéosciences
Benjamin.Pohl@u-bourgogne.fr
Daniel Joly
Laboratoire ThéMA
Université de Franche-Comté
daniel.joly@univ-fcomte.fr
Publié le 21/03/2019