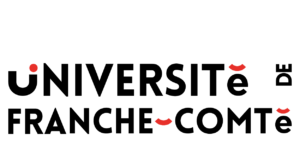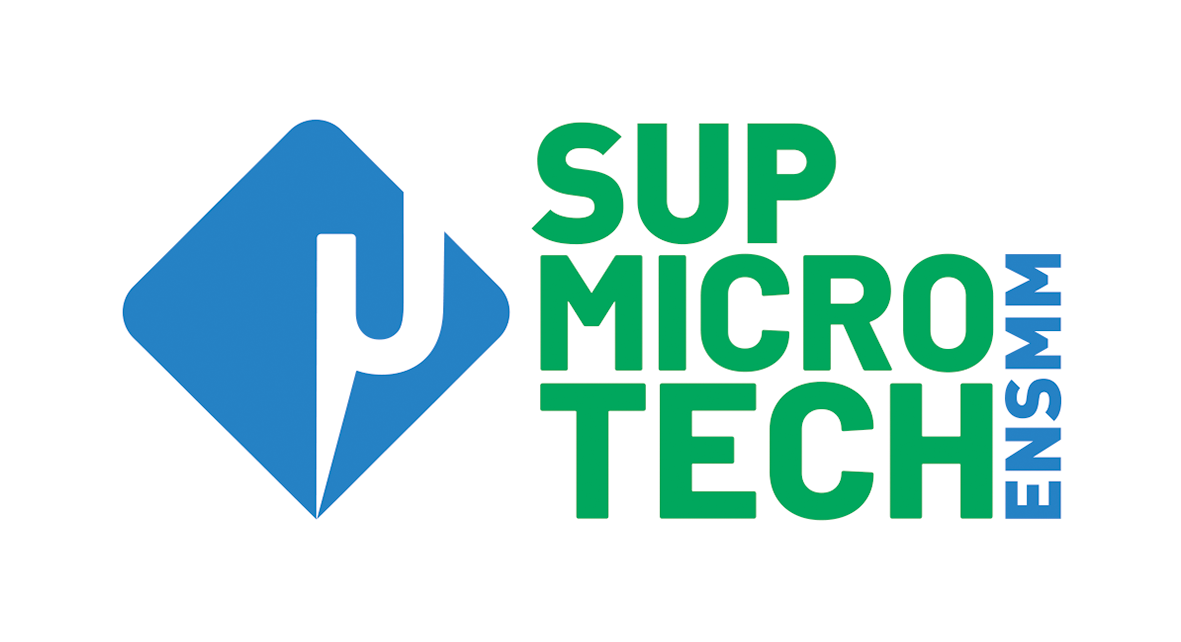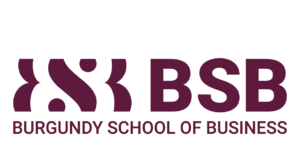La fin de vie, une question de société

Avec le débat sur l’euthanasie, le sujet de la fin de vie revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique. Mais c’est aussi une question beaucoup plus vaste, avec de véritables enjeux de société, comme l’explique Régis Aubry, co-président de la Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie portée par UBFC.
— Qu’est-ce que la fin de vie ?
Quand on parle de fin de vie, on ne fait pas seulement référence aux quelques jours ou quelques semaines qui précèdent le décès d’une personne. Les évolutions scientifiques et médicales sont telles qu’aujourd’hui, on peut vivre très longtemps avec des maladies incurables. Certaines personnes atteintes de cancers, de maladies neurodégénératives ou de lésions cérébrales majeures se retrouvent dans des situations de « fin de vie » pendant des mois, voire des années. C’est un paradigme qui n’existait pas auparavant. La fin de vie est devenue une véritable question de santé publique.
— À partir de quand parle-t-on de fin de vie ?
À partir du moment où la question de la mort devient très présente dans l’esprit de l’individu concerné. Quand une personne apprend qu’elle est atteinte d’une maladie grave, elle pense tout de suite à la mort et prend soudainement conscience de la relativité de la vie. Certaines pathologies, le vieillissement, et même certaines situations d’exclusion sociale font que des individus ont le sentiment de ne plus être, de ne plus vivre. Dans certains cas, on peut même parler de mort sociale.
— Qu’entendez-vous par là ?
J’ai été frappé par le sentiment d’indignité qui touche certaines personnes très âgées. Elles se sentent déjà mortes parce qu’elles voient bien qu’elles ne correspondent plus aux critères qui définissent un homme dans notre société moderne où il faut être jeune, rentable et performant. La question de la fin de vie est étroitement liée à celles de la vulnérabilité humaine et à celle de l’exclusion. L’idée de la mort est présente très tôt dans l’esprit des personnes pauvres, précaires, ou des migrants, comme j’ai pu le constater dans une étude que j’ai menée auprès de populations fragilisées sur le plan social. Il y a de quoi s’interroger : est-ce que notre société ne ferait pas, en quelque sorte, « mourir » certains citoyens en les excluant ? Ce sont ces questions-là aussi qui doivent intéresser la recherche. Et ces travaux de recherche pourraient générer de nouvelles formes de solidarité.

Régis Aubry est :
Responsable du pôle Autonomie et Handicap
Chef du service de gériatrie, CHU de Besançon
Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne Franche-Comté (EREBFC)
Membre du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE)
Co-Président de la Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie
— Pourquoi une plateforme nationale de recherche sur cette question ?
La question de la fin de vie fait régulièrement débat, et tout ce qui fait débat devrait faire recherche ! Or, en France, si la recherche sur la fin de vie existe, elle est peu structurée, peu visible et peu organisée en comparaison de ce qui se pratique dans certains pays d’Europe du Nord, au Canada et aux Etats-Unis. Ici, les chercheurs qui travaillent sur cette problématique ne se connaissent pas et disposent encore de peu de moyens pour travailler ensemble. L’un des objectifs de cette plateforme est justement de leur permettre de se rencontrer, d’échanger, de collaborer et de répondre des appels à projets communs.
— Comment expliquez-vous ce déficit d’échanges ?
C’est en partie lié aux cloisonnements disciplinaires. Ce sujet intéresse le champ de la médecine (soins infirmiers, gériatrie, soins palliatifs, réanimation…), mais aussi celui de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie, des neurosciences, de l’économie de la santé… Mais actuellement, chacun travaille au sein de sa propre spécialité. Or, il est nécessaire de croiser les approches et les regards. La fin de vie des personnes âgées, par exemple, ne concerne pas seulement les gériatres, mais aussi les architectes, les domoticiens, les sociologues… Même l’intelligence artificielle, dont on parle beaucoup en ce moment, pourrait, si on l’utilise « intelligemment », aider à dépister, prévenir, diagnostiquer et à limiter la perte d’autonomie.
— Le lancement de cette plateforme a eu lieu les 24 et 25 octobre, à Paris, dans les locaux du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Comment se sont déroulées ces journées ?
Il s’agissait de la première édition des Universités de la Recherche, qui sont l’une des actions menées dans le cadre de cette plateforme. Ce sont des rencontres scientifiques annuelles destinées à valoriser les recherches en cours et à nourrir les réflexions. Ce lancement a été un véritable succès, avec beaucoup de jeunes dans la salle. Le dialogue a été riche et une véritable dynamique s’est crée. Nous allons décliner ces rencontres au niveau régional, en commençant par la Bourgogne-Franche-Comté, le 19 décembre. Outre les différents colloques, séminaires et ateliers, nous allons également mettre au point un annuaire de chercheurs, un répertoire des projets et des outils de veille scientifique, pour permettre de développer cette recherche dont les enjeux pour notre société sont fondamentaux.
La Plateforme Nationale de Recherche sur la fin de vie
http://www.ubfc.fr/recherche/plateforme-fin-de-vie/
Publié le 7/11/2018