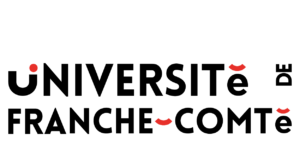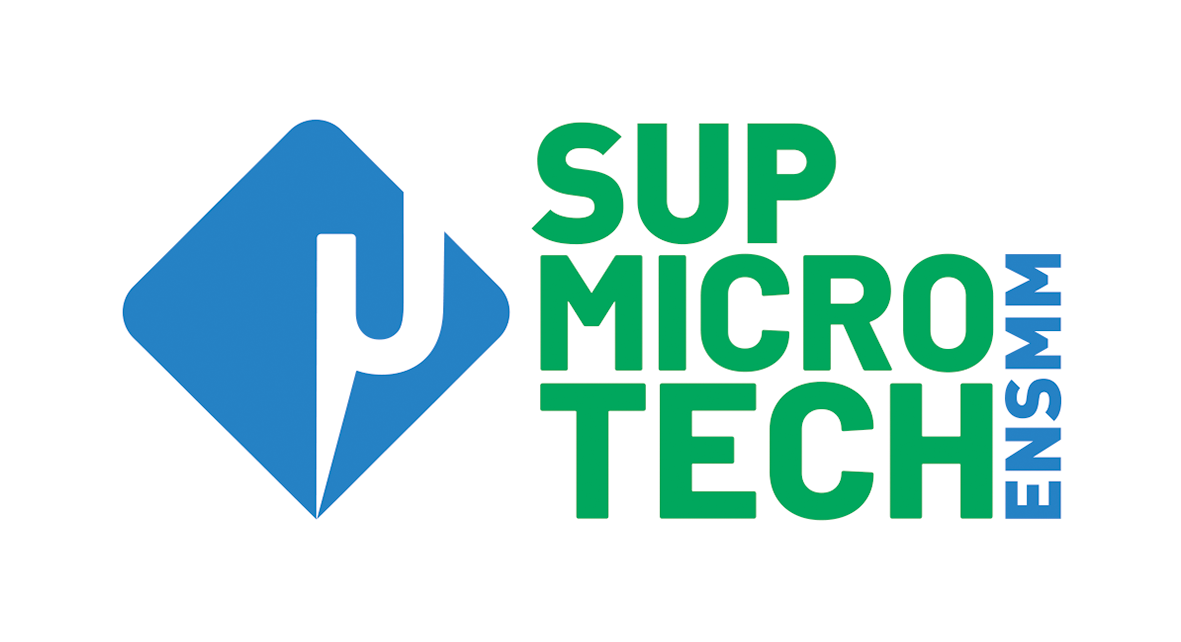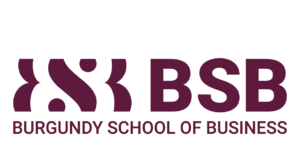Tirer les leçons de l’histoire pour mieux gérer les risques
Comment tirer les leçons des catastrophes du passé pour limiter des dégâts futurs ? Emmanuel Garnier, historien de l’environnement, propose une approche originale. Entretien.
Quel est l’objet de vos recherches ?
– Je suis historien de l’environnement. Je m’intéresse aux catastrophes naturelles ou industrielles et aux extrêmes climatiques. Quand on fouille dans les archives, on s’aperçoit que celles-ci regorgent d’informations sur l’impact de ces évènements, à tous points de vue : économique, social, géographique… Ces données sont précieuses. Elles peuvent intéresser les chercheurs qui modélisent le climat ou les événements extrêmes, car elles apportent un retour d’expérience solide en matière de fréquence et d’intensité de ce type de désastres pour les 500 dernières années. Mes travaux m’amènent à collaborer avec des spécialistes de nombreuses disciplines en sciences exactes et sciences de l’environnement.
Pourquoi étudier les catastrophes ?
– Les sciences sociales nous permettent d’analyser la manière dont ces évènements tragiques sont vécus et subis par les populations, mais aussi les stratégies d’adaptation et de résilience que celles-ci mettent en place. Elles nous donnent des pistes pour faire face à d’éventuelles futures catastrophes. Certaines communautés traditionnelles ont développé depuis des siècles, voire des millénaires, des pratiques de gestion durable de la nature et des actions pour prévenir, réduire et absorber l’impact des catastrophes. Les communautés tibétaines et Lizu (haute vallée du Mékong), par exemple, ont modelé le paysage de façon à limiter les effets des pluies diluviennes et des inondations, tandis que les feux contrôlés (Bushfire) pratiqués par les aborigènes d’Australie permettent de réduire considérablement le risque d’incendies généralisés. Ces feux contrôlés contribuent en effet à réduire la biomasse et donc des catastrophes comme on en voit tous les étés en Australie.




Votre approche est donc multiculturelle ?
– Tout à fait. Depuis 8 ans, je travaille régulièrement à l’étranger, notamment en Asie (Chine, Japon…) et en Australie. Je viens d’obtenir une bourse de la Région Bourgogne-Franche-Comté grâce à laquelle je vais être accueilli pour un an en tant que professeur invité par l’Université de Kyoto, la première université du pays, qui dispose d’un institut de recherche sur la prévention des risques très réputé. Avec cette université et celle de Tsukuba, nous collaborons sur le projet CNRS SECURE. Notre objectif est d’étudier les stratégies d’adaptation des sociétés qui font face à des risques naturels et industriels, avec une approche comparative franco-japonaise. L’accident de Fukushima a mis en évidence la vulnérabilité de nos sociétés modernes. Or, les conséquences du Tsunami et du tremblement de terre sont largement dues à l’augmentation de l’exposition de la population au cours des décennies précédentes (construction d’habitations dans des zones vulnérables par exemple). En France, les problématiques sont les mêmes, comme on a pu le voir avec la tempête Xynthia en 2010.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ?
– Le projet SECURES implique des ingénieurs, des géologues, des économistes, des historiens, des sociologues et des anthropologues… ensemble, nous établissons un véritable dialogue interdisciplinaire pour mieux comprendre ces catastrophes. En extrayant des données historiques des archives françaises et japonaises et en les interprétant, nous allons tirer les leçons du passé pour tenter d’améliorer les systèmes d’alerte et de prédiction. Dans un second temps, l’équipe de chercheurs va collaborer avec les décideurs politiques et les communautés elles-mêmes, pour élaborer ensemble des stratégies d’adaptation. Les japonais développent des méthodes intéressantes pour inciter les populations à se prendre en charge face aux risques : les gens se réunissent et se concertent localement pour désigner les maisons les plus à risques en cas de catastrophe, les personnes fragiles… et définir ensemble comment réagir. Cela permet non seulement d’élaborer des plans d’action consensuels, mais aussi de recréer du lien social.
Votre approche a intéressé l’ONU, semble-t-il ?
– Oui, effectivement, l’United Nation office for Disaster Risk Reduction m’a chargé de la rédaction d’un chapitre dans son rapport global d’évaluation sur les risques (GAR 19)*, à propos des connaissances de par le monde qui peuvent être réinvesties comme un élément de méthode de gestion des risques. Il s’agit d’utiliser les retours d’expérience du passé pour mieux prévenir les catastrophes, et de mieux s’y préparer afin d’en atténuer les effets.
Vous êtes également impliqué dans un projet financé par ISITE-BFC ?
– Oui, il s’agit du projet PubPrivlands. La Bourgogne-Franche-Comté a un taux de boisement très élevé, et nous avons une vraie opportunité de développer l’excellence en matière forestière dans la région. Les leçons qu’on peut tirer des pratiques anciennes sont très utiles : les communautés locales ont développé depuis le Moyen-âge une sylviculture proche de la nature, dont nous pouvons nous inspirer pour trouver des modes de gestion durable.
* Le comité de l’ONU pour l’application des accords de Sendeï a sélectionné cette contribution pour être publié dans un volume spécial de la revue Disaster Prevention and Management Journal.

Publié le 17/09/2019